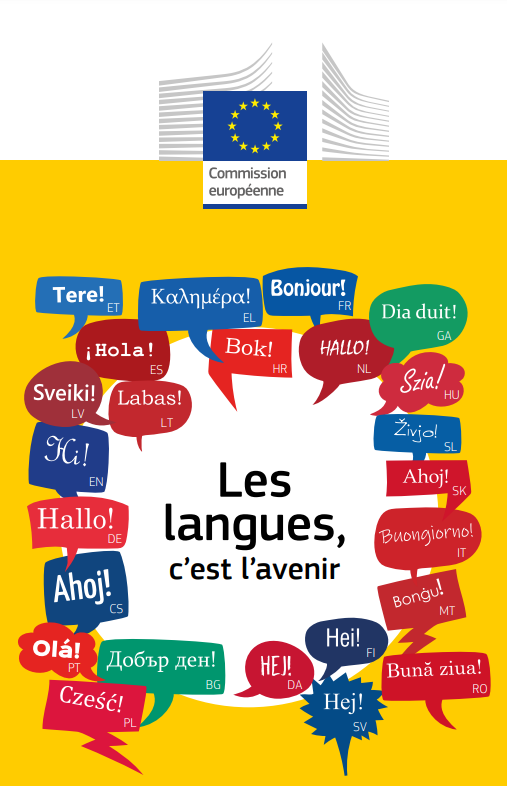Notre Platt, trésor européen en Moselle
En tant qu’habitants plattophones, nous avons souvent un rôle involontaire dans le recul de notre langue : lorsque nous la considérons comme une langue désuète, vestige du passé, ce qui contribue à lui ôter sa légitimité.
Les institutions officielles, quant à elles, restent largement insuffisantes : elles multiplient les conférences franco-allemandes, mais ces démarches ne répondent pas aux besoins et aux réalités des jeunes locuteurs. Nos élus locaux semblent parfois privilégier leur présence sur les réseaux sociaux montrant leurs belles dents blanches, et les événements festifs, plutôt que de s’atteler aux véritables enjeux et aux réponses que les citoyens attendent.
Carte des limites des dialectes Franciques
Les jeunes hésitent à parler l’allemand (et toute langue proche de celle-ci) car on leur a souvent transmis l’idée que cela pouvait rappeler des périodes sombres de l’histoire (nazisme, guerre, occupation). Ce malaise historique s’est ajouté à une politique linguistique qui, pendant longtemps, a découragé et sanctionné l’usage des dialectes. Après la guerre de 39/45, les enseignants avaient pour mission d’éradiquer le Platt (francique), considéré comme la langue de l’ennemi. Les punitions pouvaient aller des coups de règle à la mise au coin, ce qui a contribué à installer un sentiment de culpabilité et une autocensure durable dans la transmission familiale.
Cette répression a fortement fragilisé l’image du Platt, au point qu’il n’était plus “bien vu” de le parler, d’autant que son accent caractéristique exposait les locuteurs aux moqueries et au mépris du secteur franco-français.
Avant d'entrer dans le monde du travail, la jeunesse est confrontée au choix d'une ou plusieurs langues étrangères pour accompagner les études.
Nuançons tout de même, que le choix des langues durant les études est d’autant plus délicat : si par exemple vous voulez être styliste, vous pouvez avoir intérêt à apprendre l'italien, Milan étant considéré comme la capitale du design. Dans l'aéronautique, vous aurez à utiliser l'anglais au quotidien. Si vous êtes attirés par l'Amérique du Sud, l'espagnole sera à privilégier. Et si vous envisagez de travailler en Suisse, en Allemagne ou dans l'Est de la France, l'allemand s’avère indispensable... Mais pour faire ces choix, il faut savoir dans quel domaine on souhaite travailler, ce qui n’est pas une mince affaire pour tous.
Pour les Mosellans qui ne sont pas tentés par de lointaines destinations et qui souhaitent trouver plus tard un travail non loin de leur région d'origine, ce serait logiquement l'allemand.
Pour ceux qui le pratiquent, le Platt servira alors incontestablement de passerelle vers l’allemand standard.
À cause de tout cela, beaucoup de jeunes se tournent vers l’anglais : une langue “moderne”, “internationale”, perçue comme plus valorisée socialement. Mais, bien souvent, ils n’en retiennent qu’une forme superficielle, une sorte de code universel, sans véritablement s’imprégner de la culture qui l’accompagne. Ce savoir reste alors limité et n’apporte pas toute la richesse que l’on pourrait en attendre.
Pendant ce temps, ils délaissent une culture qui leur est proche, dense, façonnée par l’expérience et les épreuves traversées par leurs grands-parents, et qui demeure encore à portée de main. En la négligeant, ils risquent de l’enterrer avec ceux qui l’ont portée.
Cela fait perdre l’opportunité de préserver une langue qui est non seulement un patrimoine local, mais aussi une passerelle vers l’allemand standard.
Il est bon de rappeler, d’ailleurs, que le Platt plonge ses racines très loin dans l’histoire : il était la langue de Charlemagne. Bien sûr, il ne s’agissait pas du même dialecte qu’aujourd’hui, mais cela illustre la profondeur historique de cet héritage.
Renoncer au Platt, c’est aussi renoncer à une partie de notre mémoire. Nos anciens, ceux qui ont vécu les deux guerres mondiales, étaient souvent bilingues ou dialectophones. Le Platt faisait partie de leur quotidien, de leur identité. Ne pas le transmettre, c’est rompre ce lien avec leurs vécus, mais aussi leurs richesses culturelles.
Ne pas parler Platt, dans une région tournée vers l'Europe, devient un handicap majeur et n’apporte aucun avantage concret aux jeunes d’ici, où bon nombre d’entre eux cherchent du travail hors sol de nos frontières nationales...
À titre de comparaison, les jeunes Luxembourgeois ont pleinement intégré leur langue dans les sphères sociale, culturelle et affective : ils échangent entre eux, y compris par message, en Platt. C’est pour eux une façon d’affirmer leur identité et leur appartenance culturelle dans leur quotidien. Au Luxembourg, la pratique du Platt constitue souvent un critère important lors de l’embauche : ceux qui ne le maîtrisent pas ne sont pas embauchés ou peuvent être invités à suivre des cours.
Et nous, où en sommes-nous ? Si nous parlions davantage le Platt, nous faciliterions aussi notre apprentissage de l’allemand, en limitant accessoirement les problèmes liés à l'élocution pour favoriser une meilleure intégration professionnelle et culturelle.
Tout comme les Luxembourgeois, les Alsaciens affichent fièrement leur biculturalité, ils utilisent leur langue et leur culture sur tous les plans (économique, politique et sociétal). Dans la moitié plattophone de notre département, qui compte près de 500 000 habitants, nous semblons au contraire refouler cette richesse culturelle qui devrait pourtant nous unir et nous distinguer.
En France, et particulièrement en Moselle, on parle beaucoup d’amitié franco-allemande et de coopération transfrontalière. Mais qu’en est-il réellement ? Sur le terrain, cela se traduit surtout par des déclarations politiques séduisantes, utiles pour séduire les électeurs… mais qui restent souvent sans suite. Rares sont celles qui s’accompagnent d’une réelle volonté de défendre notre patrimoine culturel, lequel continue d’être ignoré, voire méprisé, par nos propres représentants.
Mais fragilisation du Platt n’est pas due qu’à l’école ou aux politiques linguistiques : elle a aussi été amplifiée par l’arrivée de vagues migratoires liées à l’essor industriel de la Moselle après-guerre. Italiens, Polonais, puis Maghrébins sont venus s’installer ici au fil des années. Ces arrivées ont enrichi la région, mais ont aussi dilué les repères identitaires plattophones, poussant les familles à occulter encore davantage leurs racines pour mieux s’intégrer.
Aujourd’hui, une autre dynamique est à l’œuvre : de nombreux Allemands viennent s’installer dans le Steinhart. Comme il s’agit d’une émigration choisie, elle favorise mécaniquement le bilinguisme, mais peut aussi entraîner un risque de communautarisme dont les autorités locales ne semblent pas avoir pleinement conscience, d’autant qu’aucune statistique précise n’existe malgré les recensements réguliers. Ce risque de communautarisme pourrait largement diminuer avec l'utilisation réciproque de notre Platt commun, puisque la grande majorité des 20%, d’après nos analyses, de citoyens allemands habitant dans nos villages sont des plattophones allemands. Elle favorise aussi, de manière paradoxale, un bilinguisme inversé : les Allemands parlent de mieux en mieux le français tandis que nous parlons de moins en moins l’allemand. Comment pouvons-nous accepter cela sans réagir et continuer à occulter un phénomène qui n’est, au fond, rien d’autre que la perte progressive de notre identité !
Pour autant, le Platt n’est pas mort. Dans les rues du Steinhart, et dans la Moselle Germanophone, il résonne encore dans certaines familles, commerces et événements culturels. Des initiatives comme le festival Mir redde Platt ou des traductions en Platt d’œuvres connues, telle que celle du Petit Nicolas ou Le Petit Prince, montrent qu’il reste une volonté de transmission. La Schriebstubb de Sarreguemines (dirigée par Marianne Haas-Heckel) veille à promouvoir une orthographe rigoureuse du Platt, condition essentielle à sa transmission.
Cette volonté doit être soutenue : par les familles, les associations, et surtout les institutions.
Institutions dont certaines ont bien compris l’enjeu majeur de garder leur langue régionale :
Les conseils municipaux de Mulhouse et de Freiburg-im-Breisgau ont tenu une séance commune dans la cité badoise. Point principal de l'ordre du jour : le bilinguisme franco-allemand. Selon les élus, les politiques linguistiques scolaires sont insuffisantes. Michèle Lutz, la maire de Mulhouse, a formulé 5 propositions pour développer le bilinguisme dans les deux villes […] briser la crainte de faire des fautes et inciter à parler spontanément la langue du voisin en prodiguant un enseignement exempt de notation. — Source Rheinblick
La ville d'Amiens quand a elle, a signé la charte "Ma commune aime le Picard". Pendant 3 ans, la ville s’engage à promouvoir la langue régionale dans l’espace publique : “Amiens ou Anmien ! Désormais, vous trouverez cette dénomination bilingue sur les panneaux d'entrée d'agglomération de la ville. Car ce dimanche 21 septembre 2025, Hubert de Jenlis, le maire de la capitale picarde, a signé la charte "Ma commune aime le Picard" qui l’engage pendant 3 ans à valoriser la langue régionale. Ce label, créé par l’Agence régionale de la langue picarde (ARLP) propose aux municipalités de choisir 10 actions concrètes dans une liste de 37 propositions concernant la signalétique, la communication, la culture, l’enseignement et le tourisme.” — Source France3 région
Et nous que fait-on pour préserver notre Platt ?
Etre bilingue favorise l'apprentissage
Maître de conférences en psychologie, au Laboratoire de psychologie des cognitions de l'Université de Strasbourg, Éva Commissaire décrypte certaines spécificités des personnes bilingues lors d'une conférence qui se déroulera le 29 septembre 2025 à 15h au Palais universitaire de Strasbourg.
Être bilingue joue positivement sur les effets cognitifs, c'est-à-dire la capacité de contrôle de notre comportement, de notre concentration, de notre gestion des situations. Des études montrent aussi l'importance du bilinguisme sur la mémoire de travail, qui est une fonction cognitive très impliquée dans les apprentissages scolaires, comme dans le calcul mental, la lecture ou l'apprentissage d'une langue.
Cela va à l'encontre de ce qui a pu être dit dans les années d'après-guerre à savoir que parler alsacien à la maison empêchait l'apprentissage du français, tout comme en Moselle pour notre Platt. Des études récentes montrent même que les bébés ne font pas de confusion entre les différentes langues parlées dans leur environnement familial. Et le bilinguisme joue aussi favorablement contre le déclin cognitif car les avantages observés chez des enfants bilingues le sont aussi chez les personnes plus âgées. — Source Rheinblick
Ne pas agir, c’est laisser mourir une langue, un héritage et un avantage culturel unique au cœur d’une Europe en quête de repères. C’est aussi accepter de se placer en position d’infériorité face aux habitants des quatre pays qui bordent nos frontières, alors qu’eux savent tirer parti de leur patrimoine linguistique et identitaire. Préserver et transmettre le Platt, c’est au contraire affirmer notre place, renforcer notre ouverture et consolider nos atouts dans un espace transfrontalier où les langues sont des passerelles, pas des obstacles.
À l’occasion de la Journée européenne des langues, qui aura lieu le 26 septembre, nous souhaitons mettre à l’honneur la richesse de notre patrimoine culturel. Créée en 2001 par le Conseil de l’Europe, cette initiative vise à sensibiliser chacun à l’importance de l’apprentissage des langues et à promouvoir son patrimoine linguistique. Elle concerne aujourd’hui 46 pays et encourage la diversité linguistique comme valeur commune, au même titre que la démocratie ou les droits humains.
Dans ce cadre, défendre et transmettre le Platt prend tout son sens : il ne s’agit pas seulement de préserver un dialecte local, mais aussi de participer à un mouvement plus large de protection des langues régionales, souvent fragiles face à la mondialisation.
Parler Platt, c’est affirmer qu’il fait partie intégrante de l’identité mosellane, qu’il a une valeur historique et culturelle, mais aussi un rôle à jouer dans l’avenir, notamment dans la mobilité et la coopération transfrontalière.
Prenons exemple sur les échanges sincères et fructueux que les Alsaciens entretiennent avec leurs voisins allemands. Eux savent mettre en valeur leur culture et leurs traditions, tout en affirmant leur fidélité à leurs racines. Ce sont de véritables Européens dans l’action, bien au-delà des simples déclarations d’intention.
Si nous restons passifs, l’histoire nous jugera sévèrement pour avoir laissé disparaître un tel héritage sans réagir à temps. Imaginez qu’à nos frontières, nos voisins allemands maîtrisent demain mieux notre langue que nous la leur, et cela en l’espace d’une seule génération! Nos responsables politiques, nos fonctionnaires et tous ceux qui nous représentent, devront alors répondre de ce qui pourrait bien devenir une véritable gabegie linguistique.
Ne pas agir, c’est laisser disparaître une langue qui nous distingue dans notre diversité, et qui pourrait être un formidable atout pour l’avenir.